Ce qui est assez amusant dans ce projet et qui le rend
assez typique de mon travail c’est qu’il est parti d’une
intuition formelle, pas du tout d’une volonté de sens.
La proposition était très simple : de grandes tables
de forme curviligne sur des tréteaux et puis des milliers
de petits objets avec liberté de faire ce que l’on voulait
en faire.
Un vocabulaire très basique de blocs, de plaques de
bois, de plastique, de mousse, volontairement mal
équarris, qui constituaient un jeu de construction
portant en lui sa propre subversion.
Je n’ai pas de technique particulière, mais à chaque
nouveau projet je me donne une petite technique.
Je prends des outils, je me donne une règle du jeu
qui a la même vertu que la carte pour le voyageur…
Celle d’éloigner l’inquiétude ou le pathos du choix.
Les outils sont là. Reste à jouer avec, sans plus se
poser de questions.
Je commence par écrire des choses à bâtons rompus
et d’un autre côté je fais de petits croquis, je dessine
ce qui me passe par la tête. Je découpe mes papiers
en languettes, je les déplace et je construis quelque
chose avec. L’idée vient alors de la rencontre fortuite
d’une languette avec un mot, d’une languette avec un
gribouillis. C’est comme un jeu de construction. Au bout
d’un moment l’émulsion prend avec les petits bouts de
papier découpés et reclassés dans différents ordres.
La limitation et la contrainte du matériau étaient
un très fort stimulant pour l’inventivité des enfants,
à l’intersection de leurs désirs et des contingences
techniques.
C’est une chose qui m’intéresse beaucoup : l’attention
nécessaire à l’accident, l’idée d’avoir à composer avec
son discours, ses idées et puis la réalité d’un matériau.
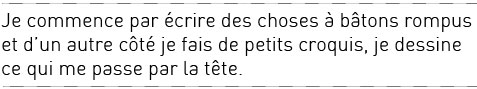
J’ai accepté de faire un blog qui, en plus de présenter
l’exposition, archivait les constructions remarquables,
rendait compte des autres projets qui m’occupaient
parallèlement. Le plus souvent, les constructions étaient
complètement inattendues et tiraient le meilleur parti
de la bizarrerie, de la non-orthogonalité des éléments.
Mon grand ami dans la matière reste Dubuffet.
Pour son côté logique et aberrant en même temps.
Sa manière d’ouvrir des parenthèses dans des
parenthèses, de faire des digressions, de revenir
sur ses pas…
L’autre source de réfl exion passionnante est l’Allemand
Friedrich Froebel (1782-1852), et les objets qu’il utilisait
pour sa pédagogie. Froebel qui est, entre autres
choses, l’inventeur du jardin d’enfants, accompagnait
l’apprentissage des enfants d’outils qu’il appelait des
dons. Il commençait par, comme l’analysait Cézanne,
un premier don composé d’une sphère, d’un cube, d’un
cylindre, qui était censés permettre aux enfants, grâce
à ce vocabulaire de base, de comprendre le monde
entier. Ainsi, il y a un livre très éclairant écrit par
Norman Brosterman, un architecte spécialiste du jeu de
construction, qui analyse l’apport de Froebel par le biais
du jardin d’enfants, à la naissance du modernisme.
Paul Cox
Extraits de l’entretien réalisé le 5 novembre 2008
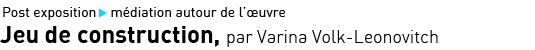
 « Je n’ai pas de technique particulière, mais à chaque nouveau projet je me donne une petite technique. Je prends des outils, je me donne une règle du jeu qui a la même vertu que la carte pour le voyageur… Celle d’éloigner l’inquiétude ou le pathos du choix. Les outils sont là. Reste à jouer avec, sans plus se poser de questions. Je commence par écrire des choses à bâtons rompus et d’un autre côté je fais de petits croquis, je dessine ce qui me passe par la tête. Je découpe mes papiers en languettes, je les déplace et je construis quelque chose avec. L’idée vient alors de la rencontre fortuite d’une languette avec un mot, d’une languette avec un gribouillis. C’est comme un jeu de construction.
« Je n’ai pas de technique particulière, mais à chaque nouveau projet je me donne une petite technique. Je prends des outils, je me donne une règle du jeu qui a la même vertu que la carte pour le voyageur… Celle d’éloigner l’inquiétude ou le pathos du choix. Les outils sont là. Reste à jouer avec, sans plus se poser de questions. Je commence par écrire des choses à bâtons rompus et d’un autre côté je fais de petits croquis, je dessine ce qui me passe par la tête. Je découpe mes papiers en languettes, je les déplace et je construis quelque chose avec. L’idée vient alors de la rencontre fortuite d’une languette avec un mot, d’une languette avec un gribouillis. C’est comme un jeu de construction.
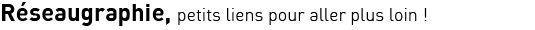
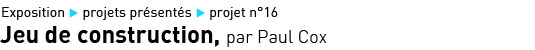


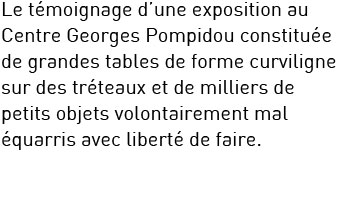

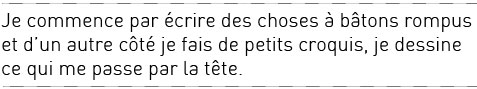



 Paul Cox au centre Georges Pompidou
Paul Cox au centre Georges Pompidou